
Défis 2025
Clique pour découvrir chacun des défis.

Acrotec / Adaptez le savoir-faire microtechnique horloger pour faire face aux montagnes russes de son marché !

Acrotec / Adaptez le savoir-faire microtechnique horloger pour faire face aux montagnes russes de son marché !
Le challenger
Acrotec est un groupe indépendant de professionnels spécialisés dans la micromécanique de précision. Démarré en 2001, il est maintenant constitué d’une trentaine de sociétés ayant des sites de production en Suisse (19), en France (5), en Allemagne (2), en Irlande (2), en Asie (3), aux Etats-Unis (1) et aux Pays-Bas (1). Il comprend environ 2500 employé-e-s.
Le groupe sert différentes industries et s’est organisé en 3 divisions d’activités distinctes à savoir : l’Horlogerie-Joaillerie, la Medtech et la Précision High-Tech. L’horlogerie compte pour environ 50% du chiffre d’affaires, la Medtech 30% et le Précision High-Tech 20%. Au niveau horloger, la division qui nous intéresse ici, Acrotec est le premier fournisseur indépendant de composants de mouvement mécanique pour l’industrie horlogère suisse. Les sociétés du Groupe, dont certaines sont actives depuis plus de 100 ans, desservent l’ensemble des acteurs de ce marché avec lesquels elles entretiennent des relations de longue date.
Les produits proposés par le Groupe incluent la plupart des composants clés d’un mouvement dont les antichocs, les masses oscillantes et les ressorts de barillets, mais également les roues d’échappements, les barillets ou la raquetterie ainsi que de nombreux autres composants. Toutes les pièces produites répondent aux meilleurs standards de qualité établis par ses clients et sont conformes aux critères du Swiss Made.
Le contexte
Développé dans les montages de l’Arc Jurassien, le savoir-faire industriel microtechnique est né de l’horlogerie et fait encore aujourd’hui son succès. Il est cependant soumis à de fortes perturbations en raison du caractère cyclique de ce marché aux allures de montagnes russes.Ces perturbations mettent parfois fortement en danger l’industrie microtechnique et en particulier les sous-traitants.Pour cette raison le groupe Acrotec, qui réalise une grande partie de son chiffre d’affaires dans l’horlogerie, a mis en place une stratégie de diversification de ses marchés. En effet, le savoir-faire microtechnique a un potentiel d’applications très large qui ne se limite pas à son domaine d’origine.
Le défi
Aujourd’hui, et demain, comment le groupe Acrotec pourrait-il adapter son organisation, ses technologies et ces marchés cibles pour stabiliser et valoriser son savoir-faire microtechnique ? En particulier, quels domaines pourraient bénéficier des technologies de micro-usinage qu’il maîtrise déjà et développe sans cesse (décolletage, fraisage, électro-formatage lia, laser femtoseconde, galvanoplastie et autres technologies de traitement de surface, micro-assemblage) ?
Objectifs :
Pour relever ce défi, vous devrez :
Donnez libre cours à votre imagination, votre créativité, votre ingéniosité tout en gardant un esprit pratique. A titre d’exemple, on peut citer le Micro-Lean Lab de la HE-Arc et son projet de micro-usine. Créée à l’origine pour l’autonomisation de la production et la personnalisation des produits dans le domaine horloger, elle est utilisée aujourd’hui pour des projets dans des domaines variés, comme le projet DNAMIC relatif à de l’archivage de données dans de l’ADN de synthèse.
Tenez compte dans votre analyse et votre solution :
En particulier, quelles habitudes du domaine horloger faudrait-il abandonner pour pouvoir travailler avec d’autres secteurs industriels ?
Acrotec est un groupe indépendant de professionnels spécialisés dans la micromécanique de précision. Démarré en 2001, il est maintenant constitué d’une trentaine de sociétés ayant des sites de production en Suisse (19), en France (5), en Allemagne (2), en Irlande (2), en Asie (3), aux Etats-Unis (1) et aux Pays-Bas (1). Il comprend environ 2500 employé-e-s.
Le groupe sert différentes industries et s’est organisé en 3 divisions d’activités distinctes à savoir : l’Horlogerie-Joaillerie, la Medtech et la Précision High-Tech. L’horlogerie compte pour environ 50% du chiffre d’affaires, la Medtech 30% et le Précision High-Tech 20%. Au niveau horloger, la division qui nous intéresse ici, Acrotec est le premier fournisseur indépendant de composants de mouvement mécanique pour l’industrie horlogère suisse. Les sociétés du Groupe, dont certaines sont actives depuis plus de 100 ans, desservent l’ensemble des acteurs de ce marché avec lesquels elles entretiennent des relations de longue date.
Les produits proposés par le Groupe incluent la plupart des composants clés d’un mouvement dont les antichocs, les masses oscillantes et les ressorts de barillets, mais également les roues d’échappements, les barillets ou la raquetterie ainsi que de nombreux autres composants. Toutes les pièces produites répondent aux meilleurs standards de qualité établis par ses clients et sont conformes aux critères du Swiss Made.
Le contexte
Développé dans les montages de l’Arc Jurassien, le savoir-faire industriel microtechnique est né de l’horlogerie et fait encore aujourd’hui son succès. Il est cependant soumis à de fortes perturbations en raison du caractère cyclique de ce marché aux allures de montagnes russes.Ces perturbations mettent parfois fortement en danger l’industrie microtechnique et en particulier les sous-traitants.Pour cette raison le groupe Acrotec, qui réalise une grande partie de son chiffre d’affaires dans l’horlogerie, a mis en place une stratégie de diversification de ses marchés. En effet, le savoir-faire microtechnique a un potentiel d’applications très large qui ne se limite pas à son domaine d’origine.
Le défi
Aujourd’hui, et demain, comment le groupe Acrotec pourrait-il adapter son organisation, ses technologies et ces marchés cibles pour stabiliser et valoriser son savoir-faire microtechnique ? En particulier, quels domaines pourraient bénéficier des technologies de micro-usinage qu’il maîtrise déjà et développe sans cesse (décolletage, fraisage, électro-formatage lia, laser femtoseconde, galvanoplastie et autres technologies de traitement de surface, micro-assemblage) ?
Objectifs :
Pour relever ce défi, vous devrez :
- Identifier une ou plusieurs industries / marchés bien adaptés à ces technologies
- Illustrer au travers d’un support (démonstrateur, application, vidéo…) un cas d’utilisation concret regroupant plusieurs technologies de micro-usinage d’Acrotec pour la fabrication d’un produit de cette industrie / ce marché.
Donnez libre cours à votre imagination, votre créativité, votre ingéniosité tout en gardant un esprit pratique. A titre d’exemple, on peut citer le Micro-Lean Lab de la HE-Arc et son projet de micro-usine. Créée à l’origine pour l’autonomisation de la production et la personnalisation des produits dans le domaine horloger, elle est utilisée aujourd’hui pour des projets dans des domaines variés, comme le projet DNAMIC relatif à de l’archivage de données dans de l’ADN de synthèse.
Tenez compte dans votre analyse et votre solution :
- des contraintes spécifiques d’intégration de certains marchés (règlementation par exemple pour le domaine médical)
- des obstacles culturels / sociologiques / psychologiques qui empêchent souvent les entreprises d’un secteur de réaliser les changements ou remises en cause nécessaires à l’accès à un nouveau marché.
En particulier, quelles habitudes du domaine horloger faudrait-il abandonner pour pouvoir travailler avec d’autres secteurs industriels ?
Château de Boudry / Faites du château un lieu vivant et fédérateur, ancré dans le présent tout en honorant son passé !

Château de Boudry / Faites du château un lieu vivant et fédérateur, ancré dans le présent tout en honorant son passé !
Le challenger
Un château qui ne manque pas de bouteille, mais qui gagne à être connu !
Perché sur une colline au cœur du vignoble neuchâtelois, le Château de Boudry est un joyau historique alliant patrimoine et tradition. Édifié au XIIIe siècle, il a su préserver son charme médiéval et son rôle emblématique dans la région.
Aujourd’hui, il abrite le Musée de la vigne et du vin, qui met en lumière l’histoire et le savoir-faire vigneron à travers une riche collection d’objets, d’outils et d’archives exposés de manière permanente et temporaire.
Son cachet unique, ses salles de banquet ainsi que sa cour surplombant l’Areuse et le vieux village en font un lieu prisé pour divers événements.
En sous-sol, l’œnothèque cantonale présente tous les encavages régionaux et propose leurs produits à la dégustation et la vente.Symbole d’un terroir vivant et d’une riche histoire, le Château de Boudry est un incontournable pour découvrir l’âme viticole de Neuchâtel !
Le contexte
Le Château de Boudry est un espace partagé entre le musée, les salles de banquet et les acteurs du terroir neuchâtelois. Profitant de synergies, chacun bénéficie de l'énergie des autres pour faire rayonner ce lieu d’exception. Avec l’arrivée d’un nouveau conservateur en 2024, de nouvelles ambitions émergent pour mieux exploiter son potentiel patrimonial, culturel et touristique.
Le défi
Nous proposons aux étudiant-e-s de réfléchir à des solutions pour :
Ces objectifs offrent des approches libres et pluridisciplinaires : communication, gestion, muséologie, architecture, événementiel, informatique... Chaque compétence peut contribuer à développer des outils bénéfiques, qu’ils soient théoriques ou concrets. Durant trois jours, il s’agira d’imaginer des solutions concrètes et innovantes, ainsi que les ressources pour leur mise en place. Application mobile, nouveau plan d’exposition, capteurs d’humidité, escape room, bar éphémère ou création d’un poste : les possibilités sont infinies.
Nous avons du temps, mais peu de personnel et des moyens financiers limités. Le défi est donc de trouver des solutions viables et réalistes, en tirant parti du cadre exceptionnel qu’offre le Château de Boudry, ou de proposer une réflexion plus globale sur l’amélioration des conditions d’exploitation de l’institution. Ensemble, faisons du château et du musée des lieux vivants et fédérateurs, ancrés dans le présent tout en honorant leur passé.
Un château qui ne manque pas de bouteille, mais qui gagne à être connu !
Perché sur une colline au cœur du vignoble neuchâtelois, le Château de Boudry est un joyau historique alliant patrimoine et tradition. Édifié au XIIIe siècle, il a su préserver son charme médiéval et son rôle emblématique dans la région.
Aujourd’hui, il abrite le Musée de la vigne et du vin, qui met en lumière l’histoire et le savoir-faire vigneron à travers une riche collection d’objets, d’outils et d’archives exposés de manière permanente et temporaire.
Son cachet unique, ses salles de banquet ainsi que sa cour surplombant l’Areuse et le vieux village en font un lieu prisé pour divers événements.
En sous-sol, l’œnothèque cantonale présente tous les encavages régionaux et propose leurs produits à la dégustation et la vente.Symbole d’un terroir vivant et d’une riche histoire, le Château de Boudry est un incontournable pour découvrir l’âme viticole de Neuchâtel !
Le contexte
Le Château de Boudry est un espace partagé entre le musée, les salles de banquet et les acteurs du terroir neuchâtelois. Profitant de synergies, chacun bénéficie de l'énergie des autres pour faire rayonner ce lieu d’exception. Avec l’arrivée d’un nouveau conservateur en 2024, de nouvelles ambitions émergent pour mieux exploiter son potentiel patrimonial, culturel et touristique.
Le défi
Nous proposons aux étudiant-e-s de réfléchir à des solutions pour :
- Améliorer la collaboration entre les acteurs
- Valoriser le château et le musée tout en élargissant leur public
- Améliorer l’expérience des visiteurs-euses
- Renforcer la communication
- Imaginer des modèles de gestion innovants et durables
Ces objectifs offrent des approches libres et pluridisciplinaires : communication, gestion, muséologie, architecture, événementiel, informatique... Chaque compétence peut contribuer à développer des outils bénéfiques, qu’ils soient théoriques ou concrets. Durant trois jours, il s’agira d’imaginer des solutions concrètes et innovantes, ainsi que les ressources pour leur mise en place. Application mobile, nouveau plan d’exposition, capteurs d’humidité, escape room, bar éphémère ou création d’un poste : les possibilités sont infinies.
Nous avons du temps, mais peu de personnel et des moyens financiers limités. Le défi est donc de trouver des solutions viables et réalistes, en tirant parti du cadre exceptionnel qu’offre le Château de Boudry, ou de proposer une réflexion plus globale sur l’amélioration des conditions d’exploitation de l’institution. Ensemble, faisons du château et du musée des lieux vivants et fédérateurs, ancrés dans le présent tout en honorant leur passé.
Club 44 / Démocratisez la culture du son – le studio sonore du Club 44 !

Club 44 / Démocratisez la culture du son – le studio sonore du Club 44 !
Le challenger
Le Club 44 porte dans son nom la date de sa création. Créé en 1944 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce centre de conférences, de débats et de rencontres voulait rendre sa place à une parole libre dans une vision humaniste. Son fondateur, l’industriel Georges Braunschweig, l’imagina comme un espace de pré-réseau social à échelle locale, favorisant la transmission de savoir, mais surtout sa remise en question. D’abord club privé dont les soirées étaient réservées à ses membres, le Club 44 est devenu en 1984 une association culturelle à but non lucratif reconnue comme un lieu apolitique et areligieux ouvert à un public large et varié, à l’image des multiples thématiques abordées. Son financement est assuré par les pouvoirs publics, par la Loterie Romande et autres fondations, par des sponsors, par les membres, les locations et les recettes de billetterie. Depuis, le Club 44 fonctionne au rythme d’un événement par semaine, principalement des conférences, rencontres, débats et tables-rondes, parfois des concerts, lectures ou autres performances. Il organise aussi plusieurs expositions par année.
Le contexte
Dès son origine, cette institution culturelle s’est apparentée à une plateforme médiatique interactive utilisant les conférences comme prémices à des débats d’une même durée, permettant aux auditeur-trices d’être pleinement actif-ves.
Durant sa première décennie d’existence, les activités du Club 44 se limitaient à la conférence du jeudi soir. En 1957, avec l'emménagement dans les nouveaux locaux conçus par l'architecte A. Mangiarotti, il diversifia ses activités, devenant un véritable lieu de culture. Sous la direction artistique de Gaston Benoît, premier délégué culturel, des moments furent dédiés aux loisirs, aux voyages, au cinéma, à la musique et à la littérature. Une galerie d'art fut même inaugurée.
Durant la pandémie de COVID, le Club 44, a bénéficié d’une aide de la Confédération et du Canton pour faire construire un studio son de qualité professionnelle afin de maintenir et d’élargir son programme culturel durant et après le confinement. En octroyant son aide, le Service de la culture du canton a demandé que ce studio puisse aussi bénéficier à d’autres initiatives culturelles, associatives ou citoyennes.Depuis sa création, le studio a été utilisé par le Club 44 pour éditer trois séries de podcasts et par quelques associations pour effectuer certains enregistrements. Il pourrait être utilisé encore bien davantage. Bien que le studio soit, de fait, à disposition de la population, son utilisation reste quasi nulle.
A ce jour, le Club n’a pas encore trouvé un concept qui valorise ce studio, ni un mode d’organisation qui permettrait concrètement de partager cet espace technique avec d’autres, sans mettre en péril l’organisation quotidienne de l’administration.
Le défi
Il s’agit de proposer un moyen concret et innovant de promouvoir, démocratiser et multiplier les usages du studio son du Club par les actrices et acteurs culturel-les et sociaux de la région.
La proposition devra inclure :
Une attention particulière aussi à la dimension éthique des voies de diffusion est attendue. En parallèle, il serait également primordial de tenir compte des synergies et complémentarités possibles avec d’autres studios en ville de la Chaux-de-Fonds également mis à disposition de la population tels que TPR Fabric'audio et l’Usine électrique, burning sound lab. Une vision générale pourrait également être proposée pour valoriser toutes ces infrastructures techniques de qualité en tant qu’atout de développement et de promotion pour La Chaux-de-Fonds. Comme beaucoup d'institutions culturelles, le Club 44 cherche à rajeunir son public. Une nouvelle stratégie de communication et une programmation audacieuse y contribuent déjà. Le développement de podcasts dans les années à venir devrait également jouer un rôle essentiel dans cette dynamique.
Le Club 44 porte dans son nom la date de sa création. Créé en 1944 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce centre de conférences, de débats et de rencontres voulait rendre sa place à une parole libre dans une vision humaniste. Son fondateur, l’industriel Georges Braunschweig, l’imagina comme un espace de pré-réseau social à échelle locale, favorisant la transmission de savoir, mais surtout sa remise en question. D’abord club privé dont les soirées étaient réservées à ses membres, le Club 44 est devenu en 1984 une association culturelle à but non lucratif reconnue comme un lieu apolitique et areligieux ouvert à un public large et varié, à l’image des multiples thématiques abordées. Son financement est assuré par les pouvoirs publics, par la Loterie Romande et autres fondations, par des sponsors, par les membres, les locations et les recettes de billetterie. Depuis, le Club 44 fonctionne au rythme d’un événement par semaine, principalement des conférences, rencontres, débats et tables-rondes, parfois des concerts, lectures ou autres performances. Il organise aussi plusieurs expositions par année.
Le contexte
Dès son origine, cette institution culturelle s’est apparentée à une plateforme médiatique interactive utilisant les conférences comme prémices à des débats d’une même durée, permettant aux auditeur-trices d’être pleinement actif-ves.
Durant sa première décennie d’existence, les activités du Club 44 se limitaient à la conférence du jeudi soir. En 1957, avec l'emménagement dans les nouveaux locaux conçus par l'architecte A. Mangiarotti, il diversifia ses activités, devenant un véritable lieu de culture. Sous la direction artistique de Gaston Benoît, premier délégué culturel, des moments furent dédiés aux loisirs, aux voyages, au cinéma, à la musique et à la littérature. Une galerie d'art fut même inaugurée.
Durant la pandémie de COVID, le Club 44, a bénéficié d’une aide de la Confédération et du Canton pour faire construire un studio son de qualité professionnelle afin de maintenir et d’élargir son programme culturel durant et après le confinement. En octroyant son aide, le Service de la culture du canton a demandé que ce studio puisse aussi bénéficier à d’autres initiatives culturelles, associatives ou citoyennes.Depuis sa création, le studio a été utilisé par le Club 44 pour éditer trois séries de podcasts et par quelques associations pour effectuer certains enregistrements. Il pourrait être utilisé encore bien davantage. Bien que le studio soit, de fait, à disposition de la population, son utilisation reste quasi nulle.
A ce jour, le Club n’a pas encore trouvé un concept qui valorise ce studio, ni un mode d’organisation qui permettrait concrètement de partager cet espace technique avec d’autres, sans mettre en péril l’organisation quotidienne de l’administration.
Le défi
Il s’agit de proposer un moyen concret et innovant de promouvoir, démocratiser et multiplier les usages du studio son du Club par les actrices et acteurs culturel-les et sociaux de la région.
La proposition devra inclure :
- une définition des usager-ères potentiel-les (étude de « marché » qui fasse sens avec la mission du Club) ;
- un modus operandi pour son fonctionnement ;
- un planning technique et sécuritaire pour l’usage du lieu et des supports informatiques y associés ;
- et, nerf de la guerre, un budget raisonnable en vue des financements actuels et potentiels du Club.
Une attention particulière aussi à la dimension éthique des voies de diffusion est attendue. En parallèle, il serait également primordial de tenir compte des synergies et complémentarités possibles avec d’autres studios en ville de la Chaux-de-Fonds également mis à disposition de la population tels que TPR Fabric'audio et l’Usine électrique, burning sound lab. Une vision générale pourrait également être proposée pour valoriser toutes ces infrastructures techniques de qualité en tant qu’atout de développement et de promotion pour La Chaux-de-Fonds. Comme beaucoup d'institutions culturelles, le Club 44 cherche à rajeunir son public. Une nouvelle stratégie de communication et une programmation audacieuse y contribuent déjà. Le développement de podcasts dans les années à venir devrait également jouer un rôle essentiel dans cette dynamique.
D/CLIC terroirs / Valorisez la viande locale dans la restauration collective !

D/CLIC terroirs / Valorisez la viande locale dans la restauration collective !
Le challenger
D/CLIC terroirs est une plateforme de distribution de produits du terroir destinée à la restauration et au commerce de détail. Fondée en 2021 au Val-de-Ruz, cette coopérative permet aux producteurs et productrices locaux de proposer leurs spécialités sans avoir à gérer la logistique. En favorisant les circuits courts, D/CLIC concentre la valeur ajoutée dans la région et réduit considérablement les distances parcourues. La coopérative a pour mission de centraliser l’offre régionale sur une plateforme commune afin d’en améliorer la visibilité et la distribution. Elle permet aux producteurs et productrices de mutualiser les coûts et la charge de travail tout en garantissant un prix juste et une maîtrise des décisions. En soutenant une production locale, durable et respectueuse des normes en vigueur, D/CLIC terroirs encourage une agriculture responsable, une consommation plus engagée et un rapprochement entre celles et ceux qui produisent et consomment. La construction d’un centre logistique a été lancée en novembre 2024 en collaboration avec la commune de Val-de-Ruz.
Le contexte
La viande est l'une des productions phares du canton de Neuchâtel, c’est un fait qui a ses raisons historiques, sociales et agronomiques. Certes, à l’échelle globale, la production et la consommation de viande posent aujourd’hui question par rapport aux enjeux climatiques, écologiques et de santé. Dès lors, est-il possible de défendre la durabilité de cette production locale ? La réponse de notre coopérative est : oui, à condition de repenser nos pratiques de consommation : moins, mais mieux ! Pour opérer cette transformation, l’approvisionnement local et la restauration collective s’offrent comme leviers de choix.
Avec ces objectifs, notre coopérative souhaite s'impliquer activement dans le Plan Climat du canton de Neuchâtel, qui encourage l’utilisation de produits régionaux dans la restauration collective. En favorisant une consommation de viande raisonnée sous le principe du "moins mais mieux", nous contribuons à une économie locale dynamique et réduisons l’empreinte carbone en limitant les transports.
Un premier enjeu majeur, tant sur le plan économique qu’environnemental, est d'éviter le gaspillage en veillant à ce que l’ensemble de l’animal trouve preneur. Or, certains morceaux sont plus prisés que d’autres, ce qui complique la planification de la production.
Nous devons donc trouver un équilibre entre l’offre et la demande dans la restauration collective tout en respectant des budgets souvent serrés. Comment structurer cette organisation sans imposer aux acheteurs de prendre une bête entière ?
Par ailleurs, dans un circuit court de consommation, le lien entre client et producteur est un élément clé. Nos client-e-s expriment un fort intérêt pour connaître l’origine précise de leur viande, notamment le nom de l’éleveur. Toutefois, pour répondre à des volumes de commande importants, il est souvent nécessaire de regrouper les productions de plusieurs éleveurs. L’installation prochaine d’un boucher dans notre centre de Cernier nous aidera à garantir cette transparence, mais il est également essentiel de réfléchir à des collaborations avec d’autres professionnels du secteur et à notre intégration dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Le défi
Le défi proposé consiste à imaginer et mettre en place une solution qui permette :
À la coopérative de se développer durablement en augmentant son chiffre d’affaires et en consolidant son image de marque.
La solution devra respecter plusieurs contraintes :
Enfin, il sera essentiel de rester fidèle aux valeurs éthiques de la coopérative en alignant nos actions avec nos engagements tout en maintenant une flexibilité face aux fluctuations de l’offre et de la demande.
D/CLIC terroirs est une plateforme de distribution de produits du terroir destinée à la restauration et au commerce de détail. Fondée en 2021 au Val-de-Ruz, cette coopérative permet aux producteurs et productrices locaux de proposer leurs spécialités sans avoir à gérer la logistique. En favorisant les circuits courts, D/CLIC concentre la valeur ajoutée dans la région et réduit considérablement les distances parcourues. La coopérative a pour mission de centraliser l’offre régionale sur une plateforme commune afin d’en améliorer la visibilité et la distribution. Elle permet aux producteurs et productrices de mutualiser les coûts et la charge de travail tout en garantissant un prix juste et une maîtrise des décisions. En soutenant une production locale, durable et respectueuse des normes en vigueur, D/CLIC terroirs encourage une agriculture responsable, une consommation plus engagée et un rapprochement entre celles et ceux qui produisent et consomment. La construction d’un centre logistique a été lancée en novembre 2024 en collaboration avec la commune de Val-de-Ruz.
Le contexte
La viande est l'une des productions phares du canton de Neuchâtel, c’est un fait qui a ses raisons historiques, sociales et agronomiques. Certes, à l’échelle globale, la production et la consommation de viande posent aujourd’hui question par rapport aux enjeux climatiques, écologiques et de santé. Dès lors, est-il possible de défendre la durabilité de cette production locale ? La réponse de notre coopérative est : oui, à condition de repenser nos pratiques de consommation : moins, mais mieux ! Pour opérer cette transformation, l’approvisionnement local et la restauration collective s’offrent comme leviers de choix.
Avec ces objectifs, notre coopérative souhaite s'impliquer activement dans le Plan Climat du canton de Neuchâtel, qui encourage l’utilisation de produits régionaux dans la restauration collective. En favorisant une consommation de viande raisonnée sous le principe du "moins mais mieux", nous contribuons à une économie locale dynamique et réduisons l’empreinte carbone en limitant les transports.
Un premier enjeu majeur, tant sur le plan économique qu’environnemental, est d'éviter le gaspillage en veillant à ce que l’ensemble de l’animal trouve preneur. Or, certains morceaux sont plus prisés que d’autres, ce qui complique la planification de la production.
Nous devons donc trouver un équilibre entre l’offre et la demande dans la restauration collective tout en respectant des budgets souvent serrés. Comment structurer cette organisation sans imposer aux acheteurs de prendre une bête entière ?
Par ailleurs, dans un circuit court de consommation, le lien entre client et producteur est un élément clé. Nos client-e-s expriment un fort intérêt pour connaître l’origine précise de leur viande, notamment le nom de l’éleveur. Toutefois, pour répondre à des volumes de commande importants, il est souvent nécessaire de regrouper les productions de plusieurs éleveurs. L’installation prochaine d’un boucher dans notre centre de Cernier nous aidera à garantir cette transparence, mais il est également essentiel de réfléchir à des collaborations avec d’autres professionnels du secteur et à notre intégration dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Le défi
Le défi proposé consiste à imaginer et mettre en place une solution qui permette :
- De coordonner offre et demande de viande entre producteurs et restauration collective, afin d’éviter les pertes et garantir l’approvisionnement selon les besoins ;
- De valoriser l’ensemble de l’animal, sans exiger l’achat de bêtes entières, en coordonnant les demandes et besoins ;
À la coopérative de se développer durablement en augmentant son chiffre d’affaires et en consolidant son image de marque.
La solution devra respecter plusieurs contraintes :
- Maintenir des prix accessibles tout en garantissant une juste rémunération des producteurs.
- Gérer un calendrier de projet serré avec des ressources limitées.
- Faciliter et limiter un temps de travail dédié à la communication avec de nombreux acteurs internes et externes à la coopérative (éleveurs, bouchers, chefs de cuisine, équipes commerciales, logistiques, client-e-s).
- Prendre en compte les impératifs de la chaîne du froid, notamment la gestion des produits frais et congelés.
Enfin, il sera essentiel de rester fidèle aux valeurs éthiques de la coopérative en alignant nos actions avec nos engagements tout en maintenant une flexibilité face aux fluctuations de l’offre et de la demande.
ello communications / Faites des réseaux sociaux des outils au service du monde de vos rêves !

ello communications / Faites des réseaux sociaux des outils au service du monde de vos rêves !
Le challenger
ello est le fournisseur de connectivité des neuchâteloises et neuchâtelois ainsi que des entreprises, leader de son marché. En tant qu'acteur de proximité, nous nous distinguons par un service clientèle rapide et efficace. Nous distribuons les produits de notre partenaire Sunrise : internet ultrarapide, téléphonie mobile et divertissement TV. Notre équipe de 45 personnes basée à Neuchâtel est dédiée au service de 30'000 clients, particuliers et entreprises. Profondément attachés à notre région, nous soutenons l’innovation, le sport, la culture et la vie associative.
Service clientèle neuchâtelois:
Le contexte
Depuis l’arrivée d’Internet, nos modes de communication, d’apprentissage, de travail et de divertissement ont connu une révolution sans précédent. Le Covid-19 a encore accéléré cette transformation en généralisant le télétravail et l’enseignement à distance, estompant les frontières physiques du travail.
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives qui modifient encore notre manière d’interagir avec le monde numérique.En tant que futur-e-s professionnel-le-s, vous évoluez dans un monde où le numérique est omniprésent, façonnant nos modes de vie, nos interactions et notre rapport au temps.
L’hyperconnectivité est devenue une réalité incontournable, offrant d’innombrables opportunités, mais aussi des défis majeurs, notamment en matière de bien-être mental, de concentration et d’équilibre personnel.Les réseaux sociaux en particulier sont conçus pour capter notre attention, parfois au détriment de notre productivité, de notre sommeil et de nos relations humaines. Ils présentent aussi des risques au niveau collectif, par exemple quand ils sont facteurs de désinformation.
Le défi
Votre mission est de trouver une piste redoutablement efficace pour amplifier les effets positifs des réseaux sociaux et faire reculer leurs effets indésirables. Utilisez les puissantes techniques et technologies des réseaux sociaux pour donner accès à des contenus et des services bénéfiques pour les individus et la société, sous une forme saine et attractive qui saura remplacer avec succès celle qui les rend problématiques aujourd’hui.
Délivrable :
Votre équipe devra présenter sa solution sous la forme de :
Sources d’Inspiration :
Pièges à éviter :
Votre solution doit être suffisamment innovante pour éviter de tomber dans :
Financement :
La question du modèle d’affaires des réseaux sociaux (gratuité ou pas, dépendance à la publicité…) doit être considérée.
ello est le fournisseur de connectivité des neuchâteloises et neuchâtelois ainsi que des entreprises, leader de son marché. En tant qu'acteur de proximité, nous nous distinguons par un service clientèle rapide et efficace. Nous distribuons les produits de notre partenaire Sunrise : internet ultrarapide, téléphonie mobile et divertissement TV. Notre équipe de 45 personnes basée à Neuchâtel est dédiée au service de 30'000 clients, particuliers et entreprises. Profondément attachés à notre région, nous soutenons l’innovation, le sport, la culture et la vie associative.
Service clientèle neuchâtelois:
- 1 Shop au centre-ville de Neuchâtel
- 1 call center
- Des techniciens disponibles dans la journée pour un dépannage
Le contexte
Depuis l’arrivée d’Internet, nos modes de communication, d’apprentissage, de travail et de divertissement ont connu une révolution sans précédent. Le Covid-19 a encore accéléré cette transformation en généralisant le télétravail et l’enseignement à distance, estompant les frontières physiques du travail.
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives qui modifient encore notre manière d’interagir avec le monde numérique.En tant que futur-e-s professionnel-le-s, vous évoluez dans un monde où le numérique est omniprésent, façonnant nos modes de vie, nos interactions et notre rapport au temps.
L’hyperconnectivité est devenue une réalité incontournable, offrant d’innombrables opportunités, mais aussi des défis majeurs, notamment en matière de bien-être mental, de concentration et d’équilibre personnel.Les réseaux sociaux en particulier sont conçus pour capter notre attention, parfois au détriment de notre productivité, de notre sommeil et de nos relations humaines. Ils présentent aussi des risques au niveau collectif, par exemple quand ils sont facteurs de désinformation.
Le défi
Votre mission est de trouver une piste redoutablement efficace pour amplifier les effets positifs des réseaux sociaux et faire reculer leurs effets indésirables. Utilisez les puissantes techniques et technologies des réseaux sociaux pour donner accès à des contenus et des services bénéfiques pour les individus et la société, sous une forme saine et attractive qui saura remplacer avec succès celle qui les rend problématiques aujourd’hui.
Délivrable :
Votre équipe devra présenter sa solution sous la forme de :
- Une description de concept (enjeux, opportunités, impact sociétal)
- Une explication concrète de fonctionnement au travers un cas d’application précis (scénario d’usage, public cible, bénéfices attendus, techniques et technologies utilisées)
Sources d’Inspiration :
- Jeux vidéo: Reprenez l’exemple des jeux vidéo. Pendant longtemps, ils ont été perçus uniquement sous l’angle de leurs risques, supposés ou réels : addiction, isolement, troubles du sommeil, développement de comportements violents.Pourtant, avec le temps, leur potentiel positif a également été mis en lumière : création artistique, développement des compétences cognitives, renforcement de la concentration, amélioration de la mémoire, développement de la coordination motrice, et même leur utilisation en thérapie pour accompagner des jeunes en difficulté. Aujourd’hui, les jeux vidéo sont reconnus comme des outils d’apprentissage et de socialisation. https://grea.ch/actualites/le-cf-reconnait-le-potentiel-des-jeux-video/
- Alternatives existantes: Des réseaux sociaux alternatifs existent déjà permettant de reprendre le contrôle et de s’abonner à du contenu informatif ou drôle, etc … que l’on peut choisir. Par exemple : wikitok, reddit…
Pièges à éviter :
Votre solution doit être suffisamment innovante pour éviter de tomber dans :
- Une approche superficielle qui s’appuierait uniquement sur les effets positifs des réseaux sociaux et dissimulerait plus qu’elle ne résoudrait, les problèmes actuels (de type « greenwashing »)
- Une approche défensive qui se focaliserait sur la limitation des aspects négatifs et des risques actuels des réseaux sociaux plutôt que de les repenser avec un regard neuf
Financement :
La question du modèle d’affaires des réseaux sociaux (gratuité ou pas, dépendance à la publicité…) doit être considérée.
éorén / Tous geeks ! Mettez les jeunes aux commandes de leurs outils numériques !

éorén / Tous geeks ! Mettez les jeunes aux commandes de leurs outils numériques !
Le Challenger
L’éorén est le cercle scolaire des communes de Neuchâtel, Laténa, Cornaux, Cressier, du Landeron et de Lignières. Il couvre les 11 années d’école obligatoire pour environ 6’800 élèves et 380 classes réparties sur 35 collèges ou sites d’enseignements. C’est un des sept cercles scolaires du canton de Neuchâtel qui compte cinq centres, soit le Centre de La Côte, le Centre des Terreaux, le Centre du Mail, le Centre du Bas-Lac et le Centre des Deux Thielles. Ces cinq centres accueillent tous les degrés de la scolarité obligatoire des neuf communes membres du Syndicat intercommunal.
Le service de Prévention et de Promotion de la santé de l’éorén est composé d’infirmières, d’assistantes dentaires et de médecins scolaires.
Ses missions principales sont :
Le contexte
Hyper-connectivité : la dépendance aux réseaux sociaux et aux écrans de manière générale représente des risques pour la santé pour les jeunes à différents niveaux, qu’il semble difficile d’éviter compte tenu de leur rôle dans le développement de la vie sociale des adolescents, entre autres. Ces risques sont renforcés par la difficulté pour les jeunes de maîtriser les applications mobiles qu’ils utilisent, comme les réseaux sociaux qui s’appuient sur des algorithmes au fonctionnement obscur pour le grand public.
Le défi
Comment l’éorén pourrait-elle contribuer au développement des compétences numériques des jeunes pour leur permettre, entre autres, d’être maîtres des applications mobiles qu’ils utilisent, et les sensibiliser notamment aux risques liés à l’hyper-connectivité ? Les étudiant-e-s sont invité-e-s à travailler sur une solution pour des élèves de 10-12 ans (8e ou 9e année de la scolarité obligatoire). C’est un âge qui correspond souvent à la première possession d’un smartphone par les enfants, qui quittent à ce moment-là l’école primaire et reçoivent un smartphone pour communiquer avec leurs proches.
Les étudiant-e-s sont invité-e-s à concevoir des activités pédagogiques sous la forme :
L’outil proposé doit pouvoir être mis en place facilement au sein d’une école et/ou en classe. Il doit tenir compte des initiatives/informations déjà existantes et proposées dans les écoles, pour les compléter, les développer ou s’en inspirer selon les cas. Par exemple : Jeunes et médias.
L’éorén est le cercle scolaire des communes de Neuchâtel, Laténa, Cornaux, Cressier, du Landeron et de Lignières. Il couvre les 11 années d’école obligatoire pour environ 6’800 élèves et 380 classes réparties sur 35 collèges ou sites d’enseignements. C’est un des sept cercles scolaires du canton de Neuchâtel qui compte cinq centres, soit le Centre de La Côte, le Centre des Terreaux, le Centre du Mail, le Centre du Bas-Lac et le Centre des Deux Thielles. Ces cinq centres accueillent tous les degrés de la scolarité obligatoire des neuf communes membres du Syndicat intercommunal.
Le service de Prévention et de Promotion de la santé de l’éorén est composé d’infirmières, d’assistantes dentaires et de médecins scolaires.
Ses missions principales sont :
- Promotion de la santé (ateliers d’éducation à la santé): La promotion de la santé a pour but de donner aux élèves davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer pour parvenir à un état de complet bien-être.
- Lutte contre les facteurs de risque et prévention des maladies (visites médicales de rattrapages, dépistages et protocoles médicaux individuels): La prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies et des traumatismes. Elle est orientée sur des problèmes de santé spécifiques dont elle essaie d’empêcher l’apparition.
- Promotion de l’égalité des chances en matière de santé: Selon les directives de la santé scolaire du canton de Neuchâtel.
Le contexte
Hyper-connectivité : la dépendance aux réseaux sociaux et aux écrans de manière générale représente des risques pour la santé pour les jeunes à différents niveaux, qu’il semble difficile d’éviter compte tenu de leur rôle dans le développement de la vie sociale des adolescents, entre autres. Ces risques sont renforcés par la difficulté pour les jeunes de maîtriser les applications mobiles qu’ils utilisent, comme les réseaux sociaux qui s’appuient sur des algorithmes au fonctionnement obscur pour le grand public.
Le défi
Comment l’éorén pourrait-elle contribuer au développement des compétences numériques des jeunes pour leur permettre, entre autres, d’être maîtres des applications mobiles qu’ils utilisent, et les sensibiliser notamment aux risques liés à l’hyper-connectivité ? Les étudiant-e-s sont invité-e-s à travailler sur une solution pour des élèves de 10-12 ans (8e ou 9e année de la scolarité obligatoire). C’est un âge qui correspond souvent à la première possession d’un smartphone par les enfants, qui quittent à ce moment-là l’école primaire et reçoivent un smartphone pour communiquer avec leurs proches.
Les étudiant-e-s sont invité-e-s à concevoir des activités pédagogiques sous la forme :
- D’un programme définissant les connaissances et compétences de base qu’il faudrait acquérir pour mieux comprendre et maîtriser les outils/applications que vont utiliser ces jeunes sur leur smartphone afin de limiter les risques de ces outils sur leur santé, vie sociale, vie privée…etc.
- D’un exemple d’activité pédagogique ludique de type initiation / découverte qui pourrait être proposée pour démarrer ce programme, si possible, avec du matériel concret, prêt à l’emploi par les enseignant-e-s ou infirmières scolaires
L’outil proposé doit pouvoir être mis en place facilement au sein d’une école et/ou en classe. Il doit tenir compte des initiatives/informations déjà existantes et proposées dans les écoles, pour les compléter, les développer ou s’en inspirer selon les cas. Par exemple : Jeunes et médias.
La Bâtisse à réemploi / Réutilisez pour mieux construire et revalorisez des métiers essentiels !
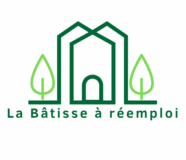
La Bâtisse à réemploi / Réutilisez pour mieux construire et revalorisez des métiers essentiels !
Le Challenger
La Bâtisse à réemploi est un projet développé dans la cadre du programme ACTIVATION du hub Neuchâtel et en passe de devenir une entreprise Sàrl.
Cofondée par une architecte et une spécialiste en finance, cette société s’est donné comme mission de récupérer et de valoriser des matériaux de construction pour ensuite les réutiliser dans de nouveaux projets immobiliers.
L’entreprise vise à faciliter le réemploi auprès de ses client-e-s architectes, institutionnels, et propriétaires de bâtiments, en leur proposant des services sur mesure pour identifier, inventorier les matériaux, organiser la logistique, suivre et gérer les interventions jusqu’à la remise des matériaux en circulation.
Elle aspire également à structurer une économie circulaire dans le canton de Neuchâtel en créant une ressourcerie, lieu dédié au stockage, au reconditionnement et à la vente de matériaux en seconde main. Cet espace permettra aux professionnel-le-s et particuliers d’accéder plus facilement à ces ressources et de favoriser les échanges.
À terme, l’entreprise ambitionne aussi de valoriser les métiers du bâtiment et du réemploi afin de préserver des savoir-faire essentiels à un secteur en pénurie de main-d’œuvre.
Le contexte
En Suisse, le réemploi des matériaux de construction reste limité faute d'obligations légales et de sensibilisation à la durabilité. Son développement repose donc sur des initiatives volontaires, souvent confrontées à une image péjorée du réemploi et à des habitudes de travail freinant l’adoption de solutions circulaires.
Pourtant, la demande pour des alternatives durables progresse et plusieurs pays européens imposent déjà des réglementations en ce sens. En Suisse, des dispositifs de valorisation pourraient accélérer cette transition et créer un effet d’entraînement. Quelques ressourceries récupèrent et réutilisent déjà des matériaux, prouvant la faisabilité de ces initiatives, mais aucun projet similaire n’existe encore dans le canton de Neuchâtel.
Le réemploi des matériaux, encore peu encouragé par la législation, doit devenir une pratique reconnue et valorisée socialement, culturellement et économiquement. Cela permettrait de renforcer la durabilité et de préserver des métiers essentiels en voie de disparition.
Pour y parvenir, il est primordial de créer des synergies entre les acteurs clés du secteur :
Le défi
Le défi est de concevoir une solution incitative, évolutive et engageante pour promouvoir et ancrer le réemploi des matériaux. Cela implique :
La Bâtisse à réemploi est un projet développé dans la cadre du programme ACTIVATION du hub Neuchâtel et en passe de devenir une entreprise Sàrl.
Cofondée par une architecte et une spécialiste en finance, cette société s’est donné comme mission de récupérer et de valoriser des matériaux de construction pour ensuite les réutiliser dans de nouveaux projets immobiliers.
L’entreprise vise à faciliter le réemploi auprès de ses client-e-s architectes, institutionnels, et propriétaires de bâtiments, en leur proposant des services sur mesure pour identifier, inventorier les matériaux, organiser la logistique, suivre et gérer les interventions jusqu’à la remise des matériaux en circulation.
Elle aspire également à structurer une économie circulaire dans le canton de Neuchâtel en créant une ressourcerie, lieu dédié au stockage, au reconditionnement et à la vente de matériaux en seconde main. Cet espace permettra aux professionnel-le-s et particuliers d’accéder plus facilement à ces ressources et de favoriser les échanges.
À terme, l’entreprise ambitionne aussi de valoriser les métiers du bâtiment et du réemploi afin de préserver des savoir-faire essentiels à un secteur en pénurie de main-d’œuvre.
Le contexte
En Suisse, le réemploi des matériaux de construction reste limité faute d'obligations légales et de sensibilisation à la durabilité. Son développement repose donc sur des initiatives volontaires, souvent confrontées à une image péjorée du réemploi et à des habitudes de travail freinant l’adoption de solutions circulaires.
Pourtant, la demande pour des alternatives durables progresse et plusieurs pays européens imposent déjà des réglementations en ce sens. En Suisse, des dispositifs de valorisation pourraient accélérer cette transition et créer un effet d’entraînement. Quelques ressourceries récupèrent et réutilisent déjà des matériaux, prouvant la faisabilité de ces initiatives, mais aucun projet similaire n’existe encore dans le canton de Neuchâtel.
Le réemploi des matériaux, encore peu encouragé par la législation, doit devenir une pratique reconnue et valorisée socialement, culturellement et économiquement. Cela permettrait de renforcer la durabilité et de préserver des métiers essentiels en voie de disparition.
Pour y parvenir, il est primordial de créer des synergies entre les acteurs clés du secteur :
- Maîtres d’ouvrage, en intégrant des exigences de réemploi dès l’appel d’offres.
- Architectes et conducteurs de travaux, en anticipant les besoins en matériaux réemployés.
- Artisan-ne-s, en mettant en avant leur savoir-faire pour déposer soigneusement les matériaux et les réinstaller.
- Fournisseurs, en valorisant leurs invendus et en intégrant des matériaux de seconde main dans leur offre.
- Structures d’insertion et centres de formation, en développant la formation et l’emploi autour du réemploi.
Le défi
Le défi est de concevoir une solution incitative, évolutive et engageante pour promouvoir et ancrer le réemploi des matériaux. Cela implique :
- La création d’un système de reconnaissance des bonnes pratiques (points, label, communication marketing), basé sur des indicateurs clés tels que le CO₂ économisé, les tonnes de matériaux réemployés, les gains financiers et l’impact sur l’insertion professionnelle. Ce système devra être décliné selon les catégories d’acteurs (artisan-ne-s, architectes, institutions publiques), avec un volet social attractif pour intéresser les jeunes aux métiers du bâtiment.
- Le développement d’un prototype visuel ou digital illustrant la chaîne de valeur du réemploi à travers un storytelling efficace et un branding structurant (ex : plateforme interactive, label visuel, outil de suivi).
- L’identification des collaborations stratégiques à mettre en place au sein du canton ou avec des expériences similaires ailleurs pour développer la solution de manière viable et pérenne.
Objectif:ne / Région Montagnes neuchâteloises / La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 / Imaginez comment héberger le monde de la culture pour repenser l’accueil régional !

Objectif:ne / Région Montagnes neuchâteloises / La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 / Imaginez comment héberger le monde de la culture pour repenser l’accueil régional !
Le challenger Objectif:ne est une association réunissant quatre groupements de communes du canton de Neuchâtel, formant chacun une région cohérente et fonctionnelle. Elle accompagne ses régions membres en facilitant leur réflexion stratégique et en soutenant la conception et la mise en œuvre de projets régionaux. La Région Montagnes Neuchâteloises (RMN) est une association de neuf communes : La Brévine, Brot-Plamboz, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel et La Sagne. Son objectif est de favoriser les collaborations intercommunales, de définir une vision partagée du développement régional et de concrétiser des projets issus de cette vision commune. La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (CCS 2027) est l’association en charge d’imaginer et de réaliser la première édition de cette manifestation culturelle qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds du 1er janvier au 31 décembre 2027. Le contexte La Ville de La Chaux-de-Fonds sera la première Capitale culturelle suisse en 2027. Le programme culturel prévu pour cette année exceptionnelle mettra l'accent sur les rencontres entre actrices et acteurs culturels aux niveaux local, national et international. Entre événements d'envergure, spectacles intimistes et expériences gustatives, le public sera invité à découvrir, échanger et s'émerveiller tout au long de cette année placée sous le signe de la culture. Cette manifestation est une opportunité pour la Région Montagnes Neuchâteloises de :
- Valoriser et développer la création culturelle sous toutes ses formes ;
- Renforcer son attrait touristique ;
- Renforcer son rayonnement national et international autour du slogan : « Espace de liberté et de création ».
SWIZA / Redonnez ses lettres de noblesse au couteau suisse et ouvrez-lui de nouveaux horizons !

SWIZA / Redonnez ses lettres de noblesse au couteau suisse et ouvrez-lui de nouveaux horizons !
Le challenger
SWIZA est un fleuron de l’industrie jurassienne, héritière d’une longue tradition horlogère et d’un savoir-faire exceptionnel dans le domaine de la coutellerie. Avec seulement deux marques de couteaux de poche certifiées Swiss Made, SWIZA se positionne fièrement sur un marché de niche haut de gamme, en s'adressant à des amateurs d'objets esthétiques, fonctionnels et durables. Cette clientèle privilégie le respect de l’environnement, apprécie les activités de plein air et adopte un mode de vie contemporain.
Le contexte
Le couteau suisse est un symbole internationalement reconnu de l’innovation helvétique et de la qualité suisse. Il incarne des valeurs de nature, de débrouillardise et de convivialité dans l’imaginaire collectif suisse. Cependant, sa commercialisation à l’international se heurte à plusieurs obstacles. D’une part, certaines réglementations en font un objet considéré comme une arme, entraînant des restrictions dans divers moyens de transport. D’autre part, au-delà des frontières suisses, il peut être perçu comme un objet potentiellement subversif ou violent, freinant ainsi son adoption comme cadeau ou accessoire du quotidien.
Ces défis, à la fois juridiques et culturels, sont cruciaux pour SWIZA. Comment redonner au couteau suisse ses lettres de noblesse et lui permettre de « voyager » plus librement à travers le monde ?
Le défi
Imaginer l’avenir du couteau suisse
L’objectif de ce projet est d’imaginer soit un nouveau produit, une évolution du produit existant, un produit complémentaire ou toute autre solution innovante permettant à SWIZA de conquérir de nouveaux marchés. Cette réflexion devra intégrer les contraintes légales et culturelles liées à la vente d’un couteau tout en conservant l’ADN de la marque.
Dans ce cadre, les étudiant-e-s devront :
En relevant ce défi, les étudiant-e-s contribueront à renforcer la dimension universelle et intemporelle de cet icone suisse, tout en participant à l’essor international d’une marque emblématique de l’artisanat helvétique.
SWIZA est un fleuron de l’industrie jurassienne, héritière d’une longue tradition horlogère et d’un savoir-faire exceptionnel dans le domaine de la coutellerie. Avec seulement deux marques de couteaux de poche certifiées Swiss Made, SWIZA se positionne fièrement sur un marché de niche haut de gamme, en s'adressant à des amateurs d'objets esthétiques, fonctionnels et durables. Cette clientèle privilégie le respect de l’environnement, apprécie les activités de plein air et adopte un mode de vie contemporain.
Le contexte
Le couteau suisse est un symbole internationalement reconnu de l’innovation helvétique et de la qualité suisse. Il incarne des valeurs de nature, de débrouillardise et de convivialité dans l’imaginaire collectif suisse. Cependant, sa commercialisation à l’international se heurte à plusieurs obstacles. D’une part, certaines réglementations en font un objet considéré comme une arme, entraînant des restrictions dans divers moyens de transport. D’autre part, au-delà des frontières suisses, il peut être perçu comme un objet potentiellement subversif ou violent, freinant ainsi son adoption comme cadeau ou accessoire du quotidien.
Ces défis, à la fois juridiques et culturels, sont cruciaux pour SWIZA. Comment redonner au couteau suisse ses lettres de noblesse et lui permettre de « voyager » plus librement à travers le monde ?
Le défi
Imaginer l’avenir du couteau suisse
L’objectif de ce projet est d’imaginer soit un nouveau produit, une évolution du produit existant, un produit complémentaire ou toute autre solution innovante permettant à SWIZA de conquérir de nouveaux marchés. Cette réflexion devra intégrer les contraintes légales et culturelles liées à la vente d’un couteau tout en conservant l’ADN de la marque.
Dans ce cadre, les étudiant-e-s devront :
- Analyser et expliquer les cadres culturels et juridiques contraignants liés à la commercialisation internationale du couteau suisse.
- Valoriser le couteau en mettant en avant son utilité, sa fonctionnalité, sa conception, bien au-delà de sa simple image d’objet tranchant.
- Proposer des solutions permettant au couteau de « voyager » dans des environnements où les réglementations sécuritaires sont strictes.
- Prendre en compte les contraintes industrielles propres à SWIZA, en veillant à la faisabilité technique et économique des propositions.
En relevant ce défi, les étudiant-e-s contribueront à renforcer la dimension universelle et intemporelle de cet icone suisse, tout en participant à l’essor international d’une marque emblématique de l’artisanat helvétique.
Torks.ch / Abonnez plus de monde à la transition écologique par le vélo électrique !

Torks.ch / Abonnez plus de monde à la transition écologique par le vélo électrique !
Le challenger
Torks.ch est la start-up lauréate du Prix BCN Boost 2025. Elle offre une solution d’abonnement abordable, tout compris, à un vélo électrique qui simplifie la mobilité urbaine en Suisse, en permettant à chacun-e de profiter de son propre vélo sans investissement initial ni souci d’entretien. Pour CHF 89 par mois, l’abonné-e bénéficie de son propre vélo électrique de qualité, assuré et entretenu, ainsi que d’un service de remplacement en cas d’incident. Torks.ch se positionne ainsi comme une alternative idéale entre les vélos en libre-service et l’achat d’un vélo électrique personnel, répondant aux limites de ces options. L’entreprise s’inscrit également dans la stratégie de la Confédération Suisse qui promeut l’intermodalité comme avenir de la mobilité, en répondant spécifiquement au défi du "first mile", en offrant une alternative flexible et écologique pour connecter les usagers aux réseaux de transports publics.
Le contexte
La vision de Torks.ch est de transformer la mobilité urbaine en démocratisant l’accès au vélo électrique. Facilitant l’usage quotidien de ce mode de transport, Torks.ch souhaite bâtir un écosystème de mobilité durable, flexible et sans tracas, où chaque citoyen-ne peut se déplacer en toute tranquillité, tout en participant activement à la transition écologique. Cette approche vise à avoir un impact positif tant sur l’environnement que sur la qualité de vie urbaine.
Le contexte actuel offre plusieurs opportunités. L’entreprise s’aligne avec les priorités de mobilité durable de la Confédération Suisse et de l’Union européenne. Le marché des abonnements aux vélos électriques connaît une forte croissance (16,5 % de taux de croissance annuel moyen), et le positionnement de Torks.ch dans l’intermodalité est en synergie avec d’autres opérateurs de transports publics.Le développement de Torks.ch est prévu en deux étapes importantes. En 2025, le service sera lancé manuellement avec une forte composante humaine : essais en gare, échanges directs avec les premiers abonnés, et retours d’expérience terrain. En 2026, l’expansion passera à une phase automatisée grâce à des vélostations connectées en libre-service, accessibles 24/24. Ce développement devra s’appuyer sur des partenariats stratégiques (par exemple l’ATE, les CFF, les universités…), une présence dans des événements ciblés, et un programme de parrainage favorisant la croissance organique par le bouche-à-oreille.
Le défi
Le défi est d’imaginer et de proposer pour 2026 un moyen original, efficace et peu coûteux permettant :
Cette solution devrait être réplicable à plus large échelle sans faire exploser les coûts de ressources humaines.
Torks.ch est la start-up lauréate du Prix BCN Boost 2025. Elle offre une solution d’abonnement abordable, tout compris, à un vélo électrique qui simplifie la mobilité urbaine en Suisse, en permettant à chacun-e de profiter de son propre vélo sans investissement initial ni souci d’entretien. Pour CHF 89 par mois, l’abonné-e bénéficie de son propre vélo électrique de qualité, assuré et entretenu, ainsi que d’un service de remplacement en cas d’incident. Torks.ch se positionne ainsi comme une alternative idéale entre les vélos en libre-service et l’achat d’un vélo électrique personnel, répondant aux limites de ces options. L’entreprise s’inscrit également dans la stratégie de la Confédération Suisse qui promeut l’intermodalité comme avenir de la mobilité, en répondant spécifiquement au défi du "first mile", en offrant une alternative flexible et écologique pour connecter les usagers aux réseaux de transports publics.
Le contexte
La vision de Torks.ch est de transformer la mobilité urbaine en démocratisant l’accès au vélo électrique. Facilitant l’usage quotidien de ce mode de transport, Torks.ch souhaite bâtir un écosystème de mobilité durable, flexible et sans tracas, où chaque citoyen-ne peut se déplacer en toute tranquillité, tout en participant activement à la transition écologique. Cette approche vise à avoir un impact positif tant sur l’environnement que sur la qualité de vie urbaine.
Le contexte actuel offre plusieurs opportunités. L’entreprise s’aligne avec les priorités de mobilité durable de la Confédération Suisse et de l’Union européenne. Le marché des abonnements aux vélos électriques connaît une forte croissance (16,5 % de taux de croissance annuel moyen), et le positionnement de Torks.ch dans l’intermodalité est en synergie avec d’autres opérateurs de transports publics.Le développement de Torks.ch est prévu en deux étapes importantes. En 2025, le service sera lancé manuellement avec une forte composante humaine : essais en gare, échanges directs avec les premiers abonnés, et retours d’expérience terrain. En 2026, l’expansion passera à une phase automatisée grâce à des vélostations connectées en libre-service, accessibles 24/24. Ce développement devra s’appuyer sur des partenariats stratégiques (par exemple l’ATE, les CFF, les universités…), une présence dans des événements ciblés, et un programme de parrainage favorisant la croissance organique par le bouche-à-oreille.
Le défi
Le défi est d’imaginer et de proposer pour 2026 un moyen original, efficace et peu coûteux permettant :
- D’augmenter significativement le nombre d’abonné-e-s et d’élargir le marché à d’autres cantons
- De développer et renforcer en même temps les partenariats stratégiques
- D’allonger la durée des abonnements (dépasser la saisonnalité de la demande) en promouvant l’engagement à long terme des utilisateur-trice-s (en valorisant notamment leur sentiment de contribuer à la transition écologique)
Cette solution devrait être réplicable à plus large échelle sans faire exploser les coûts de ressources humaines.
Ville de Neuchâtel / Changez notre regard sur la vieillesse en mettant en lumière la richesse des âges !
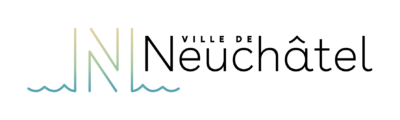
Ville de Neuchâtel / Changez notre regard sur la vieillesse en mettant en lumière la richesse des âges !
Le challenger
La Ville de Neuchâtel et plus particulièrement le service de la santé et sa déléguée aux personnes âgées souhaitent promouvoir une vision positive de la Vieillesse. Dans son rapport sur la stratégie relative au vieillissement de la population et aux défis qu’il représente, cette orientation est affirmée comme un axe prioritaire.
Le contexte
Il n’est plus à démontrer que les seniors jouent un rôle essentiel dans notre société. Leur engagement, souvent bénévole, dans des domaines très variés, en fait un pilier important de la cohésion sociale.
Pourtant, l’âgisme, forme de discrimination, de mépris ou de mise à l’écart fondée sur l’âge, reste présent dans de nombreux secteurs. Ses effets sont connus : il peut nuire à la santé des personnes concernées et favoriser leur retrait progressif de la vie sociale. Consciente de cet enjeu, la Ville de Neuchâtel souhaite adopter une posture proactive en faveur d’une représentation plus positive de la vieillesse.
Elle soutient déjà le programme Win3, mené en collaboration avec les écoles et Pro Senectute, dans lequel des seniors bénévoles interviennent en tandem avec les enseignant-e-s pour accompagner les élèves.
Mais bien d’autres initiatives restent à inventer.
Le défi
Le défi proposé consiste donc à imaginer un nouveau projet de valorisation de l’image de la vieillesse. Il peut s’agir, par exemple, d’une campagne de communication, d’un projet expérientiel, ou encore d’un événement, pour autant qu’il contribue à changer le regard porté sur les personnes âgées.
Les objectifs sont les suivants :
Le projet proposé devra pouvoir être réalisé d’ici la fin de la législature, soit entre 2024 et 2028. Par ailleurs, les ressources internes sont limitées, tant en personnel qu’en moyens financiers. Il sera donc nécessaire d’imaginer un projet qui puisse s’appuyer sur des partenariats extérieurs et mobiliser des ressources complémentaires (humaines, matérielles ou financières). Sur le plan technologique, le projet devra rester accessible aux personnes âgées. Il est important d’éviter toute solution qui pourrait renforcer la fracture numérique. Ces contraintes, qu’elles soient liées au temps politique, aux ressources disponibles ou aux caractéristiques du public cible, doivent être prises en compte dès la conception du projet. Elles représentent aussi une opportunité d’innover autrement, de proposer des solutions réalistes et créatives !
La Ville de Neuchâtel et plus particulièrement le service de la santé et sa déléguée aux personnes âgées souhaitent promouvoir une vision positive de la Vieillesse. Dans son rapport sur la stratégie relative au vieillissement de la population et aux défis qu’il représente, cette orientation est affirmée comme un axe prioritaire.
Le contexte
Il n’est plus à démontrer que les seniors jouent un rôle essentiel dans notre société. Leur engagement, souvent bénévole, dans des domaines très variés, en fait un pilier important de la cohésion sociale.
Pourtant, l’âgisme, forme de discrimination, de mépris ou de mise à l’écart fondée sur l’âge, reste présent dans de nombreux secteurs. Ses effets sont connus : il peut nuire à la santé des personnes concernées et favoriser leur retrait progressif de la vie sociale. Consciente de cet enjeu, la Ville de Neuchâtel souhaite adopter une posture proactive en faveur d’une représentation plus positive de la vieillesse.
Elle soutient déjà le programme Win3, mené en collaboration avec les écoles et Pro Senectute, dans lequel des seniors bénévoles interviennent en tandem avec les enseignant-e-s pour accompagner les élèves.
Mais bien d’autres initiatives restent à inventer.
Le défi
Le défi proposé consiste donc à imaginer un nouveau projet de valorisation de l’image de la vieillesse. Il peut s’agir, par exemple, d’une campagne de communication, d’un projet expérientiel, ou encore d’un événement, pour autant qu’il contribue à changer le regard porté sur les personnes âgées.
Les objectifs sont les suivants :
- Proposer un ou plusieurs projets pertinents et originaux qui permettent de valoriser l’image des personnes âgées, de lutter contre les stéréotypes et de montrer leur rôle actif dans la société.
- Développer un concept structuré qui s’appuie sur l’écosystème existant (associations, écoles, institutions, etc.) et, si besoin, intégrer de nouveaux partenaires.
- Identifier des pistes de financement possibles (subventions, partenariats, crowdfunding…) pour rendre le projet réalisable.
- Analyser les risques et contraintes du projet (logistique, communication, ressources, etc.) et proposer des solutions ou adaptations.
Le projet proposé devra pouvoir être réalisé d’ici la fin de la législature, soit entre 2024 et 2028. Par ailleurs, les ressources internes sont limitées, tant en personnel qu’en moyens financiers. Il sera donc nécessaire d’imaginer un projet qui puisse s’appuyer sur des partenariats extérieurs et mobiliser des ressources complémentaires (humaines, matérielles ou financières). Sur le plan technologique, le projet devra rester accessible aux personnes âgées. Il est important d’éviter toute solution qui pourrait renforcer la fracture numérique. Ces contraintes, qu’elles soient liées au temps politique, aux ressources disponibles ou aux caractéristiques du public cible, doivent être prises en compte dès la conception du projet. Elles représentent aussi une opportunité d’innover autrement, de proposer des solutions réalistes et créatives !
Viteos / Imaginez la nouvelle offre électrique verte et locale de Viteos !

Viteos / Imaginez la nouvelle offre électrique verte et locale de Viteos !
Le challenger Viteos est un acteur local innovant, partenaire de transition énergétique et vecteur de solutions durables.Référence neuchâteloise de la transition énergétique, Viteos assure la fourniture d'énergies ainsi que la gestion des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage/froid à distance à plus de 100'000 client-e-s. Viteos propose tant aux particuliers qu'aux entreprises des solutions efficientes, globales et durables dans les domaines des infrastructures, du photovoltaïque, des batteries de stockage, des pompes à chaleur ou encore de la mobilité électrique. Viteos mène également une politique environnementale et sociétale responsable, et s'engage à être un partenaire de confiance, proche de ses client-e-s. Présent en Romandie avec ses sociétés filles Swiss-Green et Betelec, le groupe Viteos emploie plus de 500 personnes.Le contexteÀ ce jour, Viteos propose trois produits électriques, tous issus de production d’énergie renouvelable :
- Vivalor (produit de base par défaut) : 90% hydraulique suisse, 10% valorisation des déchets, avec un fonds pour l'efficience énergétique locale. (+0.45 ct/kWh)
- Areuse : 100% hydraulique neuchâteloise, soutenant les nouvelles énergies locales. (+0.80 ct/kWh)
- Areuse+ : 95% hydraulique, 5% solaire local, avec un engagement pour les énergies renouvelables. (+2.40 ct/kWh)
- Repenser l’offre unique de Viteos en intégrant des packs attractifs et différenciants dans une perspective à long terme.
- Faut-il proposer une offre standard et une offre premium ? Quel prix et quelle valeur perçue pour chaque option ?
- Ajouter des avantages écologiques mesurables pour renforcer la perception d’une offre « premium ».
- Certificat vert attestant de la participation à une énergie propre.
- Éco-kit offert en fin d’année (ampoules LED, bons pour produits durables, etc.).
- Rabais sur d’autres prestations de Viteos pour encourager l’éco-responsabilité.
- Participation à des projets écologiques locaux, financée par une partie des marges.
- Identifier des associations, entreprises et collectivités engagées pour renforcer la crédibilité de la nouvelle offre.
- Explorer des solutions innovantes pour matérialiser l’engagement durable de Viteos (parrainage de projets écologiques, label qualité, etc.).
- Rendre visible l’impact écologique de la nouvelle offre au-delà d’un simple argument marketing en expliquant clairement ses bénéfices pour les consommateurs-trices et pour la planète.
- S’assurer que les clients actuels (Vivalor, Areuse, Areuse+) perçoivent positivement ce changement en identifiant et limitant les risques qu’il comporte sur leur satisfaction et l’image de l’entreprise.
- Maximiser l'adhésion à la nouvelle offre premium (y c. aux clients qui n'avaient initialement pas souscrit de produits vert premium).
- Utiliser des supports interactifs et digitaux pour visualiser l’impact écologique (simulateurs d’économie CO₂, vidéos éducatives, témoignages).
- Définir une stratégie de narration convaincante pour positionner Viteos comme un acteur incontournable de la transition énergétique.
- Imaginer des actions conjointes avec les partenaires identifiés pour maximiser l’impact et la visibilité (événements, campagnes locales, programmes de sensibilisation).
- Risque de greenwashing si la communication n’est pas claire et transparente.
- Dépendance aux partenaires et fournisseurs pour garantir la crédibilité de l’offre.
- Acceptation du public : nécessité de convaincre les consommateurs-trices de la valeur ajoutée.
- Tenir compte de la concurrence dans une optique long terme, même si la clientèle de Viteos est aujourd’hui une clientèle captive (qui ne peut pas choisir son fournisseur d’électricité)
- Renforcer l’image de Viteos comme acteur clé de la transition énergétique.
- Créer une offre différenciante et innovante sur le marché.
- Favoriser une prise de conscience et un engagement des consommateurs-trices envers une énergie plus responsable.
- Possibilité de développer d’autres offres écologiques en capitalisant sur ce premier projet.
Vivre ensemble / Valorisez de nouveaux récits collectifs pour faciliter la transition écologique et sociale !
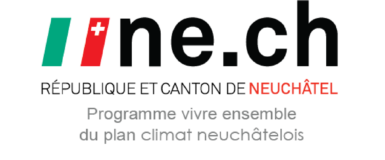
Vivre ensemble / Valorisez de nouveaux récits collectifs pour faciliter la transition écologique et sociale !
Le challenger
Le programme « vivre ensemble » est né de la volonté du Grand Conseil neuchâtelois de renforcer le Plan climat cantonal avec des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre des mécanismes d'accompagnement et des outils visant à atténuer les conséquences sociales découlant des effets du changement climatique. La mise en œuvre du programme a été confiée au Département de l'emploi et de la cohésion sociale. Ce programme, qui vise à consolider un mouvement de transition dans le long terme, dans une logique de co-construction, se déroulera jusqu'en 2027, avec un budget global de 400'000 francs.
Il comprend :
Le contexte
Le plan climat neuchâtelois est l’un des plus ambitieux de Suisse, en visant une neutralité carbone en 2040. Pour réussir à atteindre cet objectif voté par le parlement cantonal, des mesures fortes seront nécessaires et ne pourront que réussir avec une adhésion forte de la population. L’un des principaux enjeux à la mise en œuvre du plan climat neuchâtelois consiste ainsi à convaincre les Neuchâteloises et les Neuchâtelois du bien-fondé des actions prévues (transfert vers la mobilité douce, pose de panneaux solaires, …), de sorte qu’elles ne soient pas perçues comme des contraintes et des sacrifices et qu’elles ne rencontrent pas trop de résistance d’une grande partie de la population. Une manière de mettre en mouvement est de travailler sur de nouveaux récits collectifs fondés sur des initiatives et expériences concrètes dans le canton menant à une décarbonation de notre société.
Le défi
Notre défi est de proposer un moyen de valoriser ces récits et exemples. La proposition devrait ainsi permettre de se projeter dans d’autres futurs possibles, des futurs qui donnent envie et qui mettent en avant tous les bénéfices plutôt que les contraintes d’une transition sociale et écologique (lien social, temps, joie, sentiment de cohérence et justice).
Concrètement, il s’agira de :
Contraintes :
Opportunités :
Le programme « vivre ensemble » est né de la volonté du Grand Conseil neuchâtelois de renforcer le Plan climat cantonal avec des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre des mécanismes d'accompagnement et des outils visant à atténuer les conséquences sociales découlant des effets du changement climatique. La mise en œuvre du programme a été confiée au Département de l'emploi et de la cohésion sociale. Ce programme, qui vise à consolider un mouvement de transition dans le long terme, dans une logique de co-construction, se déroulera jusqu'en 2027, avec un budget global de 400'000 francs.
Il comprend :
- Des appels à projets œuvrant pour la solidarité et la coopération, en lien avec les enjeux climatiques.
- La visibilisation et valorisation des acteur-trices du canton qui s'engagent pour la transition climatique.
- La mise en réseau des acteurs et actrices et la recherche de synergies entre les projets (impliquant la société civile, le canton et les communes), notamment à l'aide d'une coordinatrice auprès de la société civile et d'organisation d'événements fédérateurs.
Le contexte
Le plan climat neuchâtelois est l’un des plus ambitieux de Suisse, en visant une neutralité carbone en 2040. Pour réussir à atteindre cet objectif voté par le parlement cantonal, des mesures fortes seront nécessaires et ne pourront que réussir avec une adhésion forte de la population. L’un des principaux enjeux à la mise en œuvre du plan climat neuchâtelois consiste ainsi à convaincre les Neuchâteloises et les Neuchâtelois du bien-fondé des actions prévues (transfert vers la mobilité douce, pose de panneaux solaires, …), de sorte qu’elles ne soient pas perçues comme des contraintes et des sacrifices et qu’elles ne rencontrent pas trop de résistance d’une grande partie de la population. Une manière de mettre en mouvement est de travailler sur de nouveaux récits collectifs fondés sur des initiatives et expériences concrètes dans le canton menant à une décarbonation de notre société.
Le défi
Notre défi est de proposer un moyen de valoriser ces récits et exemples. La proposition devrait ainsi permettre de se projeter dans d’autres futurs possibles, des futurs qui donnent envie et qui mettent en avant tous les bénéfices plutôt que les contraintes d’une transition sociale et écologique (lien social, temps, joie, sentiment de cohérence et justice).
Concrètement, il s’agira de :
- Identifier des initiatives existantes (notamment celles soutenues dans le cadre de « Vivre ensemble », mais aussi d’autres) qui pourraient inspirer des récits de futurs souhaitables.
- Créer des récits porteurs d’avenir à partir de ces exemples, en lien avec les objectifs du plan climat cantonal.
- Imaginer un dispositif de long terme pour faire vivre et valoriser ces récits auprès des jeunes.
- Définir la forme concrète de ce dispositif et expliquer comment il pourrait être mis en place.
Contraintes :
- Ne pas proposer une simple campagne de communication institutionnelle.
- Concevoir un projet sur le temps long, capable de faire émerger, transmettre et ancrer des récits inspirants dans le temps, et non une action ponctuelle au message éphémère.
Opportunités :
- Ce projet pourrait s’inscrire dans la dynamique de La Chaux-de-Fonds, Capitale Culturelle Suisse 2027.
- Il pourrait aussi trouver un prolongement dans de futurs appels à projets "Vivre ensemble" ou dans le cadre du plan climat cantonal.
